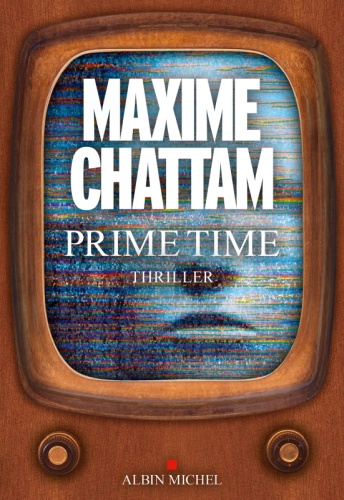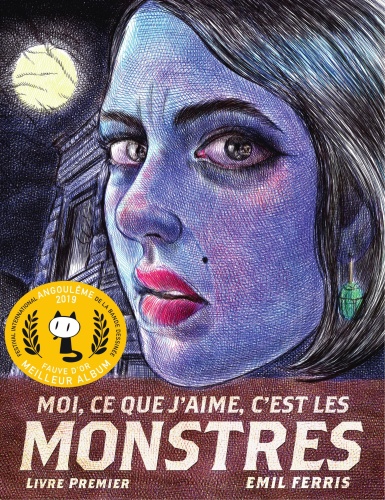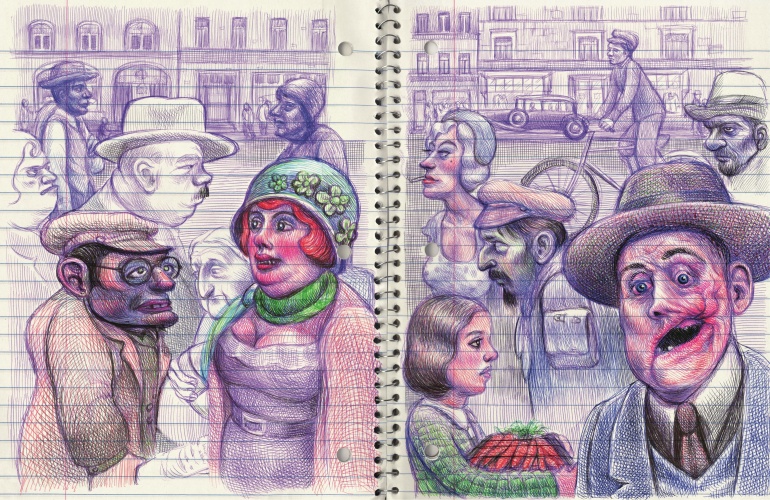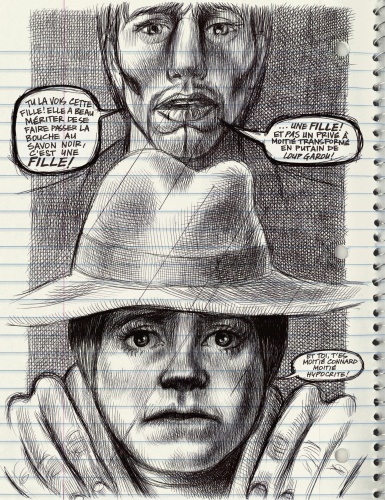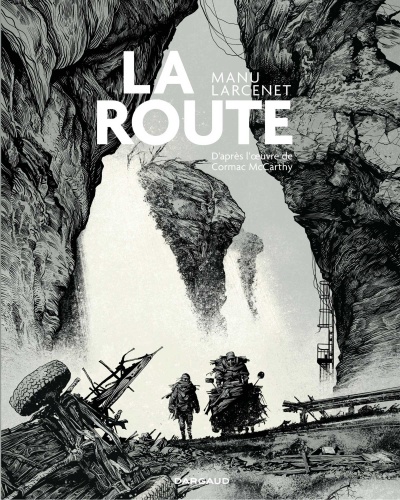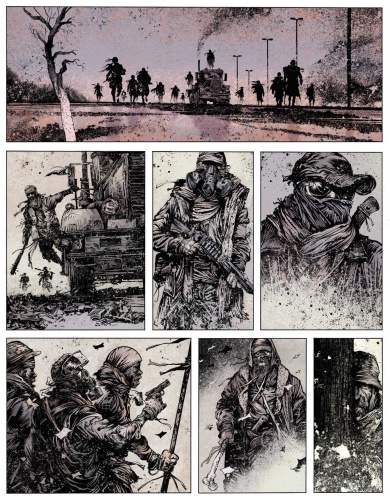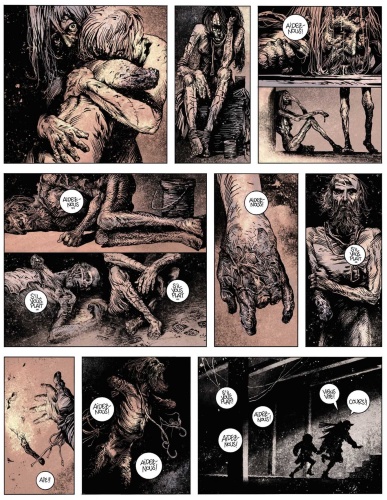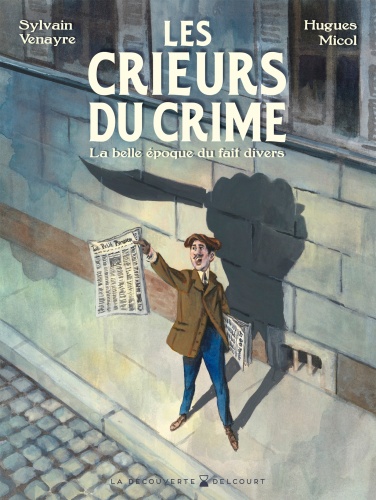AU MENU DU JOUR
Titre : Douce France – L’Étincelle
Auteur : Céline Cléber
Éditeur : Toucan
Parution : 2025
Origine : France
426 pages
De quoi ça cause ?
Tout commence un soir d’été, lorsqu’un jeune désœuvré, proche du milieu islamiste, allume l’étincelle qui manquait pour embraser une France divisée et anxieuse. Progressivement, sous les coups de boutoir d’une petite minorité d’extrémistes violents, tout le pays entre en guerre civile. Les autorités, partagées entre le cynisme, la lâcheté et l’incompréhension, ne parviennent pas à endiguer le conflit qui voit des territoires entiers entrer en sécession. Quelques individus tentent cependant, jours après jours, d’enrayer la chute, mais y parviendront-ils ?
Le lecteur entre dans les coulisses du pouvoir, en découvre les ressorts et s’interroge sur les risques pesant sur les capacités de réaction d’institutions qui n’ont que l’apparence de la solidité, fragilisées par la conjugaison de la lâcheté et de l’irresponsabilité des individus qui les constituent.
Pourquoi lui plutôt qu’un autre ?
Parce que c’est un nouveau scénario de l’effondrement de la France. L’auteure évoluant en contact direct avec les hautes sphères du pouvoir on peut légitimement supposer que les réactions politiques et les décisions qui suivront s’inscrivent dans un arbre des possibles… pas franchement rassurant dans tous les cas.
Ma Chronique
Quelques mots sur l’auteure avant d’entrer dans le vif du sujet. Céline Cléber est un pseudonyme, elle est haut fonctionnaire et, dans le cadre de ses fonctions, est amenée à côtoyer les « têtes pensantes » du pouvoir en France. De fait elle connaît parfaitement les rouages de la machine étatique, si elle admet volontiers, en avant-propos, avoir retenu la pire des hypothèses ce n’est pas pour autant que celle-ci est hautement improbable… surtout quand on voit la mollesse de nos politiques.
À l’image de Laurent Obertone (Guérilla) et de Franck Poupart (Demain Les Barbares), l’étincelle qui fera tout basculer est allumée par un proche des milieux islamistes… J’imagine déjà certains bien-pensants au bord de la nausée, prêts à hurler à la stigmatisation et à l’islamophobie (exactement comme certains acteurs du présent roman). Enlevez vos œillères messieurs dames, bien que latente, la menace n’en est pas moins réelle.
Un drame récupéré par les milieux islamistes pour dénoncer l’islamophobie grandissante de la société française et appeler les musulmans à se protéger par tous les moyens. Un exécutif timoré qui ne veut froisser personne et jouer, quel que soit le prix à payer, la carte de l’apaisement. Des forces de l’ordre et une des forces armées bridées par les consignes de ce même exécutif. Tous les signaux sont au vert pour que les choses aillent de mal en pis.
C’est justement cette escalade que Céline Cléber va s’efforcer de détailler, étape par étape, compromission après compromission… la mécanique de l’embrasement se met en branle, et rien ne semble pouvoir l’arrêter.
Certaines voix s’élèveront contre les décisions de l’exécutif, certaines actions seront même entreprises (Bevet Breizh ! Vive la Bretagne ! Fidèle à sa devise régionale : Kentoc’h mervel eget bezan saotret – Plutôt la mort que la souillure). Mais le mal est déjà profondément ancré et l’exécutif ne verra pas d’un très bon œil ces initiatives contraires à ses consignes d’apaisement (renoncement ?).
L’auteure apporte beaucoup de soins à la personnalité des ses acteurs et leurs relations / interactions. Des personnages plus complexes que l’on pourrait le penser de prime abord. Il y a ceux qui exploiteront les failles du système pour maintenir la tension à son comble tout en s’autoproclamant victimes du système. Ceux qui devront faire un choix entre leurs obligations professionnelles et leurs convictions. Puis il y a tout le cercle politique, on abat ses cartes lentement mais sûrement, sans jamais perdre de vue les possibilités de booster sa carrière.
Comme le précise fort justement Céline Cléber, certaines de ses créations politiques pourraient vous faire penser à de véritables personnalités politique de premier plan. Ce n’est pas un choix totalement fortuit.
Plus les chapitres défilaient et plus je me disais qu’un seul opus ne suffirait pas pour trouver une voie de sortie, quelle qu’elle soit. Effectivement on referme le bouquin sur une situation plus explosive que jamais, j’espère que l’auteure nous offrira une suite très prochainement.
Petit bémol à l’intention des équipes de correction des éditions Toucan. Vous ne vous êtes pas trop foulé sur ce coup les gars, il reste pas mal de coquilles qui piquent les yeux et la mise en page serait perfectible (je ne supporte pas ces phrases ajoutées immédiatement à la suite d’un dialogue, sans saut de page).
Quand Laurent Obertone nous plongeait dans le feu de l’action avec sa trilogie Guérilla, Céline Cléber nous invite dans les coulisses (d’un côté comme de l’autre) en se reposant sur son expérience et sa connaissance des milieux. Une approche différente, plus inédite, mais tout aussi intéressante.
Une mise en bouche prometteuse mais je serai tenté de dire que le plus dur reste à faire : trouver une sortie de crise tout aussi convaincante que cette étincelle. Je suis confiant, on verra si la suite me donnera raison…
MON VERDICT